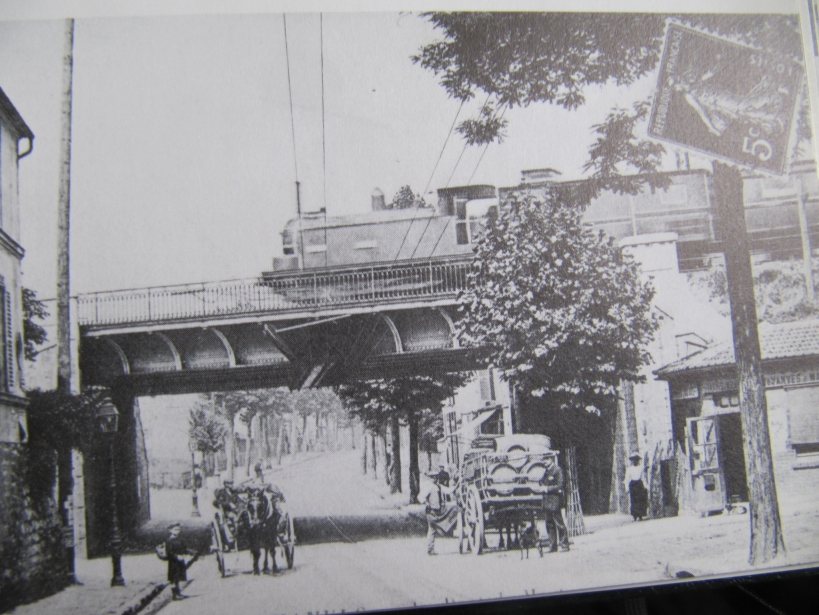Depuis le 6 avril, les Vanvéens peuvent utiliser le nouveau train Régio2N qui circulent sur la ligne N enyre Paris Montparnasse et Dreux. Ce nouveau train va remplacer progressivement l’ensemble des matériels roulants existants (VB2N et Z2N) de la ligne et ainsi répondre aux besoins de l’ensemble des 132 000 voyageurs de cette ligne N. Le parc sera à terme de 73 rames sur la ligne N, financées à 100% par Ile de France Mobilités où siége le maire de Vanves, pour un coût de 1,06 milliard d’euros. Leur circulation a nécessité des travaux de grande ampleur menés par SNCF Réseau afin d’adapter les quais, les voies et le faisceau caténaire aux caractéristiques du nouveau matériel pour un montant de 161 M€ (financés à 70% par la Région Île-de-France dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région).
Les voyageurs vanvéens verront une amélioration sensible de leurs conditions de voyages avec la présence d’accoudoirs, de prises de courant 220v installées entre les sièges mais aussi d’un éclairage homogène, permettent à chacun d’adapter son voyage à ses envies de lecture, de repos, de travail sur PC ou smartphone, etc. Ils pourront profiter, pour plus de confort en hiver, du chauffage par le sol et en été de la climatisation. Des espaces vélos sont également mis à disposition des voyageurs qui combinent train et vélo dans leurs trajets quotidiens. À tout moment, grâce au Système d’Information Voyageurs Embarqué (SIVE), ils pourriont prendre connaissance des noms et du nombre d’arrêts que comporte son trajet, de sa durée (réactualisée en fonction de la circulation) ainsi que les correspondances possibles avec d’autres trains, bus, tram, métro. Des écrans dynamiques placés sur les plateformes diffusent directement l’information en provenance des centres opérationnels Transilien. Chaque rame Regio2N embarque 25 caméras de surveillance pour permettre une couverture intégrale des plateformes et des espaces voyageurs intérieurs, et assurer la sécurité. Des éclairages ont également été ajoutés sur les plateformes afin de renforcer le sentiment de sûreté.
Ce train Regio2N, matériel à 2 niveaux est 100 % conforme aux dernières normes européennes relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il offre un accès de plain-pied aux quais,.son intérieur a été pensé pour simplifier les déplacements des personnes dont la mobilité est limitée. Par exemple, les poignées fixées aux sièges sécurisent leur cheminement dans les couloirs. De surcroit, le Regio2N est une rame dite « boa » permettant l’accès d’une voiture à l’autre de manière aisée. Des éclairages ont également été ajoutés sur les plateformes afin de renforcer le sentiment de sûreté. Ce train dispose également de capteurs qui comptent les voyageurs montant et descendant, outil indispensable pour leur apporter une info d’affluence qui leur permette de choisir les voitures les moins occupées et de se positionner en anticipation au droit de ces voitures sur le quai. Un outil deux en un qui améliore le confort de déplacement des voyageurs et participent à une meilleure ponctualité en fluidifiant les échanges entre le train et le quai.